De mes études de Lettres, je me rappelle entre autres d’un cours magistral consacré à la thématique de la Bibliothèque. J’ai conservé des dizaines de pages de cours. Malheureusement, je n’ai pas retrouvé ces feuilles… Mais je me souviens de l’intérêt que cela avait suscité en moi. Plonger dans l’histoire des bibliothèques, dans leur symbolisme, observer ces lieux de savoir à travers des auteurs tels que Umberto Eco, Guillaume de Saluste du Bartas ou encore Jorge Luis Borges m’avait laissé la saveur d’une parenthèse à la fois enchantée et presque infinie… Une porte ouverte sur un univers foisonnant à l’exégèse inépuisable.
La Bibliothèque comme représentation du monde et le bibliothécaire comme gardien d’un savoir, d’une mémoire. Ordonner les livres comme on ordonne le monde. J’avais trouvé ces prismes absolument passionnants. Et à présent que je prends la plume, tout me revient. Enfant, j’adorais ranger la bibliothèque de ma grand-mère. J’organisais les livres par ordre alphabétique ou par ordre de taille… comme une réminiscence inconsciente de ces hommes qui avaient voulu rassembler et ordonner le monde au sein de la Bibliothèque d’Alexandrie dont chaque bibliothèque porte en elle l’empreinte, le souvenir.
Fondée au IIIe siècle avant notre ère par Ptolémée Ier, général macédonien qui avait servi sous les ordres d’Alexandre Le Grand, la Bibliothèque d’Alexandrie est considérée comme la première bibliothèque au sens moderne du terme : lieu où l’on stocke les volumima (rouleaux de papyrus) et où des personnes sont affectées à l’extension du fond, à la conservation et à l’élaboration des volumina.
Logée dans le Mouséion, c’est-à-dire dans la maison des Muses, filles de la déesse Mnémosyne, le projet de la Bibliothèque d’Alexandrie avait pour dessein d’abriter la mémoire de la quasi-totalité du monde méditerranéen, de réunir l’ensemble des connaissances de l’humanité et de les transcrire en grec. À cet égard, chaque navire qui transitait dans le port d’Alexandrie devait soumettre à la bibliothèque les volumes qu’il transportait afin que ceux-ci soient copiés. On pense qu’à son apogée, la bibliothèque d’Alexandrie contenait 500 000 volumina.
Il y a dans le projet de la bibliothèque d’Alexandrie quelque chose qui rappelle l’ambition, voire la démesure, de l’épisode de la Tour de Babel. Selon le mythe, la Tour de Babel – la Porte du Ciel – avait pour objectif de rétablir l’axe primordial rompu et de s’élever par lui jusqu’au séjour des Dieux. Or, je viens de le dire, la Bibliothèque était logée dans la maison des Muses, les filles de la déesse Mnémosyne, elle-même fille de Gaia et d’Ouranos. Cette ascendance suggère que la Mémoire, et implicitement la Bibliothèque, contient dans ses gènes ce lien inhérent entre le Ciel et la Terre, entre « Dieu », les Dieux et les Hommes.
Il est également possible de lire dans le mythe de la Bibliothèque, une réminiscence du mythe du labyrinthe. Nous l’avons dit, la Bibliothèque est un microcosme qui se propose d’ordonner le monde. L’idée de cosmos – d’un monde organisé – suppose et induit la notion de chaos au sein duquel il convient de cheminer pour clarifier. Cette thématique de la bibliothèque/labyrinthe est développée dans Le Nom de la Rose d’Umberto Eco et porte en elle l’idée d’initiation, de cheminement vers la connaissance, de cheminement vers soi.
Enfin, le projet de rassembler dans un lieu unique les livres du « monde entier », l’ambition de compiler toute la mémoire « du monde » m’évoque précisément l’Art de la mémoire et notamment le théâtre de la mémoire ; structure extraordinaire imaginée et conçue par Giulio Camillo au XVIe siècle. Il s’agissait d’un théâtre de bois, suffisamment grand pour accueillir des spectateurs et dont la mission était de délivrer et d’accorder à celui qui y pénétrait la connaissance absolue. Grâce au lieu, à l’ordre et aux images qui imprégnaient dans la mémoire du spectateur les différentes étapes de la Création, l’ouvrage de Giulio Camillo permettait à l’Homme de se reconnecter à sa nature divine et de s’affranchir de sa dépendance au monde céleste. Une fois parvenu au sommet de l’édifice, l’Homme pouvait non seulement embrasser et mémoriser d’un seul regard la Création mais également sa divinité, son unité.
Je vais vite, beaucoup trop vite mais je voulais montrer – au regard de ces comparaisons à peine esquissées – que l’ordonnancement, tout comme le cheminement au sein de cet ordonnancement, présente quelque chose d’initiatique, d’introspectif, de très intime. Et c’est là que je voulais en venir. Si la bibliothèque contient dans son ADN l’ambition d’unifier et d’ordonner le monde et que cette absorption, cette assimilation de la connaissance du monde mène à notre unité, à notre unicité, la thématique d’une bibliothèque idéale que je développe ici prend alors tout son sens.
Je suis venue assez tard à l’amour de la lecture pour autant j’ai toujours été attirée par les livres en tant qu’objet, objet précieux, voire sacré. J’ai toujours eu ce besoin de posséder des livres. Il m’est arrivé d’en acheter et de ne pas les lire. Me satisfaisant pleinement et exclusivement de leur présence rassurante.
Une forme de possession qui se matérialise également dans mon rapport au livre. Je n’aime pas prêter mes livres et je n’aime pas que l’on m’en prête. Il m’arrive cependant d’en emprunter mais le fait que je ne puisse pas annoter les pages génère chez moi un manque… comme si l’on m’empêchait de tisser un lien intime avec ce dernier. Mes livres sont recouverts de notes, de remarques. Certains passages sont encadrés, certaines phrases soulignées, certains mots entourés. Le crayon a papier à la main, la conversation débute, le dialogue se cristallise et le livre me parle… de moi. Car en effet, si une œuvre m’attire c’est qu’elle dit quelque chose de moi, de mes goûts bien sûr mais peut-être quelque chose de plus intime encore… quelque chose que je ne sais pas encore.
A presto
Carole
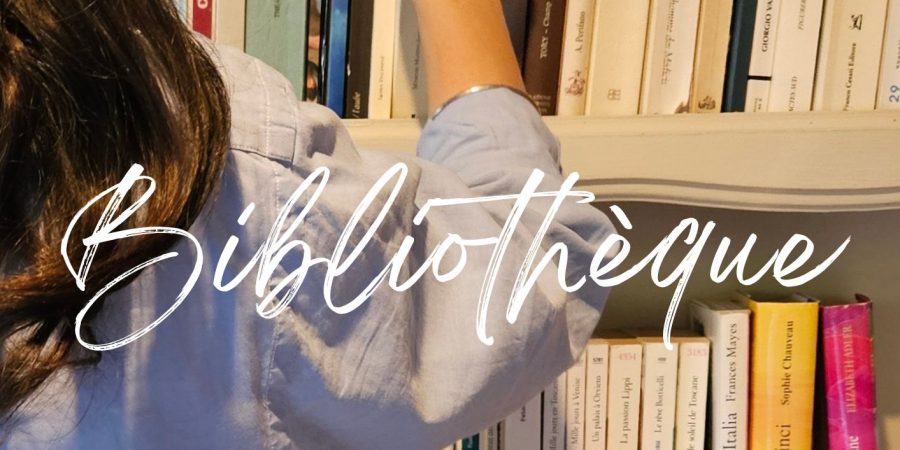
Quel plaisir de te lire. L’art de nous faire voyager simplement par des mots mais avec une grande profondeur.
J’attends ton livre 😃!
Gros bisous
Merci beaucoup Elodie, ça me touche énormément ❤️ Je t’embrasse.